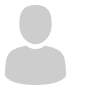 Résumé par la Pre Estibaliz LAZARO (Août 2025)
Résumé par la Pre Estibaliz LAZARO (Août 2025)Service de Médecine Interne, CHU BORDEAUX
Définition
Les intervillites chroniques d’étiologie indéterminée (ICEI) sont des pathologies rares du placenta, caractérisées par une infiltration anormale du tissu intervilleux par des macrophages maternels. Ces cellules immunitaires s’accumulent dans l’espace intervilleux, c’est-à-dire entre les villosités choriales, sans atteinte directe du trophoblaste ou du fœtus, ce qui les distingue d’autres anomalies placentaires.
Considérées comme des maladies inflammatoires à médiation immunitaire, les intervillites relèvent du champ des pathologies auto-inflammatoires et auto-immunes rares. Leur reconnaissance est cruciale du fait de leur association forte avec des complications obstétricales sévères.
Épidémiologie
- Prévalence estimée : entre 6 et 10 % dans les fausses couches inexpliquées ou morts fœtales in utero récidivantes.
- Pathologie rare mais probablement sous-diagnostiquée, du fait de l’absence d’examen placentaire systématique en cas de perte fœtale.
- Survient principalement chez des patientes sans pathologie auto-immune connue, mais une proportion significative de femmes présente des antécédents auto-immuns ou des anomalies immunitaires.
Clinique
Le tableau clinique des ICEI est peu spécifique et se manifeste uniquement par des complications obstétricales, rendant le diagnostic souvent rétrospectif, après analyse histologique du placenta.
Manifestations cliniques principales :
- Retard de croissance intra-utérin sévère (RCIU), parfois isolé, souvent associé à une MFIU.
- Prééclampsie précoce sévère, notamment avant 28 SA, en l’absence d’autres facteurs de risque.
- Fausses couches à répétition, en particulier au 2ᵉ trimestre.
- Parfois associée à une éclampsie, un hématome rétroplacentaire ou une souffrance fœtale aiguë en fin de grossesse.
Contexte évocateur :
- Absence d’explication obstétricale habituelle (pas d’infection, pas de malformation fœtale, pas de thrombophilie sévère).
- Antécédents d’échecs obstétricaux répétés sans étiologie évidente.
- Retard de croissance intra-utérin.
Diagnostic
Le diagnostic d’ICEI repose exclusivement sur l’examen histologique du placenta, post-partum ou post-fausse couche.
Critères histologiques :
- Infiltrat intervilleux composé majoritairement de macrophages CD68+ d’origine maternelle.
- Présence parfois d’une composante lymphocytaire CD3+.
- Absence de villite (atteinte des villosités) et d’infection.
- Immunohistochimie nécessaire pour confirmation : CD68, CD3, parfois CD4/CD8.
Examens complémentaires à envisager :
- Bilan immunologique maternel : recherche d’auto-anticorps (ANA, anti-phospholipides), bilan de thrombophilie, exploration HLA.
- Typage HLA mère/enfant dans le cadre d’études ou de cas complexes.
- Echographies spécialisées en cas de récidive pour surveillance rapprochée.
Évolution
Les ICEI ont une forte tendance à la récidive, ce qui en fait une pathologie à fort impact obstétrical.
- Taux de récurrence entre 30 et 70 % en l’absence de traitement.
- Complications obstétricales à chaque grossesse, souvent plus précoces et sévères.
- Evolution vers des pertes fœtales à un stade de plus en plus précoce.
- Retentissement psychologique majeur chez les patientes.
Traitement
Il n’existe pas à ce jour de traitement validé par essais cliniques randomisés, mais des stratégies thérapeutiques empiriques ont montré des résultats prometteurs en prévention des récidives, notamment dans le cadre de protocoles multidisciplinaires (internistes, obstétriciens, immunologistes, anatomo-pathologistes).
Approche thérapeutique empirique :
- Corticothérapie (prednisone 10–20 mg/j dès le début de grossesse).
- Aspirine à faible dose (100–160 mg/j dès le début de grossesse).
- HBPM à dose préventive ou intermédiaire, surtout en cas de contexte pro-thrombotique associé.
- Hydroxychloroquine (Plaquenil®), en particulier chez les patientes avec auto-immunité.
- En cas d’échec ou de récidives malgré traitement :
- Ajout possible d’immunoglobulines polyvalentes IV (IgIV).
- Tentative d’utilisation de biothérapies dans des cas très sélectionnés et après avis d’expert.
Suivi de grossesse :
- Grossesse classée à très haut risque.
- Suivi en centre spécialisé, multidisciplinaire.
- Échographies de croissance rapprochées dès le 2ᵉ trimestre.
- Surveillance doppler, monitoring fœtal, hospitalisation au moindre doute.
- Accouchement souvent déclenché précocement en cas de RCIU sévère.
Conclusion
Les ICEI constituent une entité rare mais sévère, associée à des pertes fœtales à répétition, souvent inexpliquées. Leur reconnaissance clinique repose sur une vigilance accrue face aux récidives obstétricales inexpliquées. Le diagnostic histologique est indispensable, et la prise en charge préventive repose sur une stratégie empirique associant plusieurs traitements. Un suivi multidisciplinaire spécialisé est impératif.
Référence :
Mekinian, N. Costedoat-Chalumeau, L. Carbillon, A. Coulomb-L’Hermine, V. Le Guern, A. Masseau, E. Lazaro, J. Cohen, M. Bornes, G. Kayem, O. Fain. Intervillites chroniques histiocytaires : bilan et prise en charge. La Revue de Médecine Interne. Volume 39, Issue 2, 2018 ; 117-121.
